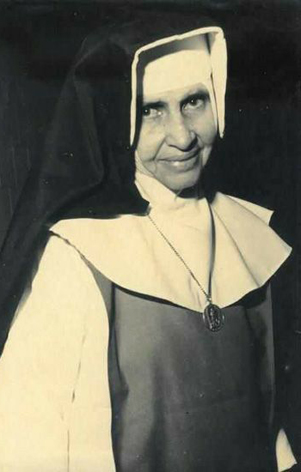
 |
Maria Rita Lopes Pontes
vient au monde dans une famille de cinq enfants de Salvador de
Bahia, au Brésil. Son père est un croyant engagé
dans les œuvres caritatives. Rita perd sa mère à
six ans. C’est une enfant heureuse, au caractère
volontaire, intelligente et attentive à tout et à
tous. Elle aime accompagner son père à la messe
et prie dans sa chambre dès qu’elle le peut. En 1927,
l’adolescente songe à devenir religieuse pour servir
Jésus dans la personne des pauvres. Elle poursuit ses
études avec brio pour devenir institutrice, menant de
front son cursus scolaire, ses activités de charité
et une vie de prière d’une rare densité. Majeure,
elle entre chez les Sœurs missionnaires de l’Immaculée
Conception de la Mère de Dieu, congrégation apostolique
fondée quelques années plus tôt au Brésil,
et prend le nom de sœur Dulce. Trois ans plus tard, elle
fonde le premier mouvement ouvrier de Salvador de Bahia, avec
l’assentiment de ses supérieures et des autorités
épiscopales : l’Union ouvrière de Saint-François,
organisme prototype, qui lui servira de modèle au fil
des années pour étendre la charité à
l’infini. C’est une petite structure d’inspiration
franciscaine qui aide les travailleurs les plus humbles sur le
plan matériel et spirituel. L’année suivante,
elle fonde avec son confesseur un cercle ouvrier qui rassemble
déjà plusieurs dizaines de nécessiteux,
SDF, adolescents déscolarisés et femmes sans ressources.
En 1939, le collège Saint-Antoine ouvre ses portes dans
un quartier désargenté de Bahia. Des religieuses
viennent y faire la classe à des enfants sans le sou.
Sœur Dulce ne possède rien elle-même, mais
le matériel scolaire est offert de façon providentielle.
Parallèlement, elle continue de recueillir un nombre croissant
d’indigents. L’année 1949 marque la date du
célèbre épisode du « poulailler »
: avec l’autorisation de sa congrégation, elle regroupe
une soixantaine de malades dans un ancien poulailler qui jouxte
une communauté religieuse dans la ville. C’est le
point de départ de ce qui va devenir le plus grand hôpital
de Bahia. Devant elle, tous les obstacles semblent fondre comme
neige au soleil. C’est réellement sans moyens humains
et matériels qu’un projet d’une telle envergure
a été mené : sans argent, sans réseau,
sœur Dulce met sur pied en quelques années une structure
hospitalière qui, aujourd’hui, coûterait des
centaines de millions d’euros. Sœur Dulce, dont le
corps est demeuré incorrompu, a été béatifiée
le 22 mai 2011, puis coninisée le 13 octobre 2019. |
|